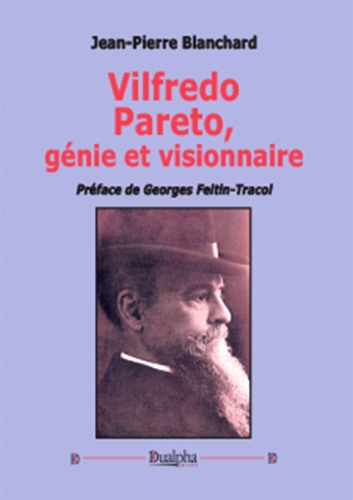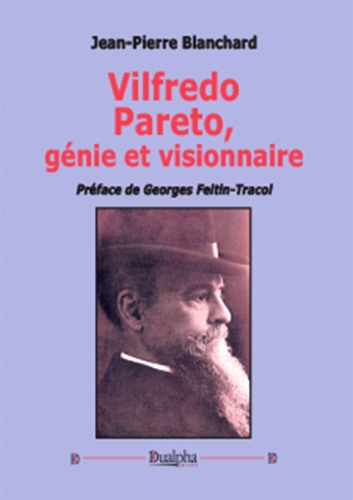
Vilfredo Pareto (né à Paris - France le 15 juillet 1848 ; décédé à Céligny - Suisse le 19 août 1923) était un sociologue et économiste italien. Il a apporté de nombreuses contributions importantes dans ces deux matières, particulièrement dans l'étude de la distribution du revenu et dans l'analyse des choix individuels. Il introduisit le concept de l'efficacité et aida le développement du champ de la microéconomie avec des idées telles que la courbe d'indifférence. Il est successeur de Léon Walras à la Chaire d'économie politique de l' Université de Lausanne.
Biographie:
Vilfredo Pareto est né en 1848 à Paris, l'épicentre des révolutions populaires de cette année. Son père était un ingénieur italien, noble, exilé d'Italie comme partisan de Mazzini, républicain et anti-piémontais, sa mère une femme française. Le grand-père paternel, Giovanni Benedetto Pareto avait été fait baron de l'Empire par Napoléon.
Pendant son enfance, en Italie, Pareto vécut dans un milieu de classe moyenne, recevant une éducation de niveau élevé.
En 1870 il est diplômé en ingénierie de l'université polytechnique de Turin. Sa thèse était intitulée « Principes fondamentaux de l'équilibre des corps solides ». Son intérêt dans l'analyse de l'équilibre en économie et sociologie y fait ses premières manifestations.
Pendant quelques années, il travaille comme ingénieur, d'abord pour la compagnie italienne des chemins de fer, publique, puis dans l'industrie privée et devient directeur des Ferriere italiane. Son travail le fait voyager.
En 1886 il devient maître de conférence à l'université de Florence. Son séjour à Florence fut marqué par son activité politique, largement alimentée par ses frustrations contre les régulateurs étatiques. Libéral, il attaque le socialisme, le militarisme et le protectionnisme du gouvernement.
En 1889, après la mort de ses parents, Pareto change de style de vie : il quitte son travail et se marie à une Russe, Alessandra Bakounine. Il commence à écrire de nombreux articles polémiques contre le gouvernement ce qui lui attire beaucoup d'ennuis comme l'interruption d'une de ses conférences par la police ou le refus d'une autorisation d'enseigner l'économie politique.
En 1893 il est nommé maître de conférence en économie à l'université de Lausanne en Suisse à la place de Walras qui le lui a proposé. Il y reste jusqu'à la fin de sa vie
En 1898, il héberge des socialistes italiens fuyant la répression des émeutes.
En 1902, sa femme le quitte. Il vivra jusqu'à sa mort avec Jeanne Régis.
En 1906, il fit la fameuse observation selon laquelle vingt pour cent de la population possédait quatre-vingt pour cent de la propriété en Italie, observation à l'origine de la loi qui porte son nom.
En 1917, l'université de Lausanne organise son jubilé.
En 1923, il conseille aux fascistes d'adopter une politique libérale.
Il meurt à Céligny (Suisse) la même année.
Sociologie
Actions logiques et non-logiques:
Son apport dans le domaine de la recherche sociologique se situe autour des concepts d'actions logiques étudiées à travers l'économie et des actions non-logiques étudiées par la sociologie. Les actions non-logiques étant constituées de résidus, c'est à dire tous les affects inhérents à l'homme. Tout son développement se trouvant dans son principal ouvrage: Traité de sociologie générale, publié en 1916 en italien et en 1917 en français.
Masse et élite:
Pareto distingue les classes sociales entre masse et élite, l'élite elle-même est séparée entre élite non gouvernementale et gouvernementale. De la masse montent perpétuellement de nouvelles élites que l'élite en place a le choix de combattre ou d'intégrer jusqu'à sa défaite et son remplacement. C'est cette lutte qui fait l'histoire. L'étude de la circulation des élites est souvent réduite à la fameuse phrase "L'histoire est un cimetière d'aristocraties".
La distinction entre élite et masse s'applique à toutes les sociétés dans des proportions similaires, et la répartition des richesses est inégalement la même partout: la seule façon d'enrichir les plus pauvres est donc d'enrichir la société toute entière plus vite qu'elle ne s'accroit.
Epistémologie:
A l'encontre des préjugés scientistes de son époque, Pareto dénie à la science la faculté de définir un système politique, une morale, une religion idéaux. Le scientisme dénature la science en la surestimant: la science ne peut déterminer les fins humaines.
Le cynisme et le pessimisme de Pareto attaquent de front l'optimisme et le rationalisme d'Émile Durkheim. Illusions sont les tentatives d'organiser rationnellement la société, illusion que de croire l'homme animé par la raison, illusion que de croire la vertu progresser avec l'accroissement de la raison.
Pareto critique également les moralistes qui développent vainement des théories pour accorder les intérêts particuliers et collectifs. Le maximum d'utilité pour la collectivité n'est pas le maximum d'utilité de la collectivité.
Politique:
Pareto est l'auteur d'une étude du socialisme dans son ouvrage Les Systèmes socialistes.
Pareto critique tout au long de son oeuvre la faiblesse des élites en fin de règne qui cause leur perte : « Toute élite qui n'est pas prête à livrer bataille, pour défendre ses positions, est en pleine décadence, il ne lui reste plus qu'à laisser sa place à une autre élite ayant les qualité viriles qui lui manquent. C'est pure rêverie, si elle s'imagine que les principes humanitaires qu'elle a proclamés lui seront appliqués : les vainqueurs feront résonner à ses oreilles l'implacable vae victis. Le couperet de la guillotine s'aiguisait dans l'ombre quand, à la fin du siècle dernier (ndlr : fin XVIIIe donc), les classes dirigeantes françaises s'appliquaient à développer leur "sensibilité". Cette société oisive et frivole, qui vivait en parasite dans le pays, parlait, dans ses soupers élégants, de délivrer le monde de "la superstition et d'écraser l'infâme", sans se douter qu'elle-même allait être écrasée. » (in Les Systèmes socialistes T.I, p.40-41)
Les régimes autoritaires:
Les fascistes italiens se sont réclamés de Pareto, mort en 1923, et on dit souvent de lui qu'il justifie les régimes autoritaires.
Réduisant la théorie de Pareto sur les élites, ils justifient leur violence comme nécessaire pour maintenir l'ordre social. Le pouvoir qu'exerce l'élite, minoritaire, n'ayant in fine pas de fondement moral, la force peut être utilisée sans complexe et le régime trouve dès lors sa justification dans son succès.
Pareto vit dans l'avènement du fascisme une réaction contre la décadence bourgeoise et son humanitarisme, un gage d'ordre. D'abord très hostile, il accueille favorablement l'avènement de Mussolini mais met en garde les fascistes contre "les aventures guerrières, la restriction de la liberté de la presse, la surimposition des riches et des paysans, la soumission à l'Église et au cléricalisme, la limitation de la liberté d'enseignement" (in Gerarchia, revue fasciste, dans un article intitulé "Liberta").
Pareto est élevé représentant de l'Italie à la Commission du désarmement de la SDN en décembre 1922 et sénateur en mars 1923. Il meurt peu après, bien avant la proclamation des lois fascistissimes.
Le libéralisme:
Sur le plan économique, il estime que le libéralisme est le système le plus producteur de richesse et par conséquent celui qui enrichit le plus la société toute entière.
Sur le plan des idées politiques, Pareto semble préférer un régime fort et libéral c'est-à-dire capable de faire respecter les libertés.
Maurice Allais voit en Pareto un grand libéral qui a cherché à réduire au maximum et dans la mesure du possible la contrainte qu'exerce la collectivité sur l'individu.
L'étatisation:
Pareto annonce avec justesse l'interventionnisme croissant des États dans l'économie qui se produira au XXème siècle qui verra l'avènement de sociétés collectivistes. La bureaucratisation se substitue à la libre initiative. Pareto compare cette évolution à celle de Byzance et à celle du Bas-Empire.
Les outils statistiques "Pareto":
Il demeure célèbre pour son observation des 20% de la population qui possèdent 80% des richesses en Italie, généralisée plus tard (par Joseph Juran et d'autres) en distribution de Pareto. Cette observation a été étendue à d'autres domaines sous le terme de « loi de Pareto ». Par extension, on appelle diagramme de Pareto un type d'histogramme où les classes sont représentées par ordre décroissant de fréquence, ce qui permet de mettre en évidence les classes les plus importantes ; ce diagramme est utilisé en gestion de la qualité, où les classes représentent les défauts.
Il définit la notion d'optimum paretien comme une situation d'ensemble dans laquelle un individu ne peut améliorer sa situation sans détériorer celle d'un autre individu. Dans la théorie des jeux de John Forbes Nash, la situation est un optimum paretien si les agents sont satisfaits de leur choix et que les gains sont maximisés. Ces gains étant optimaux, si la situation d'un agent s'améliore, celle d'un autre doit se détériorer pour préserver l'équilibre. Un optimum de Pareto est également un équilibre de Nash (où la notion d'optimum n'intervient pas), l'inverse n'est pas vrai.
Le concept d'optimum de Pareto se démarque des thèses utilitaristes qui ne se préoccupent que de la quantité totale de « bien-être » de la société (et négligent le fait que le bien-être des uns peut se faire au détriment de celui d'une minorité).
Economie:
Représentant du courant néoclassique, et plus particulièrement avec le français Léon Walras de l’école de Lausanne, Vilfredo Pareto a laissé à la littérature économique plusieurs ouvrages majeurs comme son Cours d'économie politique (1896) et son Manuel d’économie politique (1909).
Un des ses plus importants apports a été de modifier les principes de la valeur utilité chez les néoclassiques. Auparavant, un des postulats néoclassiques était l'existence d'une fonction d'utilité cardinale : l’individu rationnel est capable de déterminer le niveau absolu d’utilité d’un produit. Pareto lui substitue le principe plus réaliste d'utilité ordinale : l’individu rationnel est en fait capable de hiérarchiser ses préférences, de dire s’il préfère le produit A au produit B ou inversement.
Ce raisonnement le pousse à l’utilisation des courbes d’indifférence imaginées par Francis Edgeworth. Le principe de la courbe d'indifférence représente l’ensemble des combinaisons de deux produits, permettant d’obtenir une utilité donnée.
La généralisation de ses raisonnements à l’échelle de la société permet de déterminer la situation où l’utilisation des ressources est optimale. L’optimum de Pareto est la situation dans laquelle l’utilité (le bien-être) d’aucun individu ne peut être augmentée sans que ne soit réduite l’utilité d’un autre individu. Ce point est obtenu par l’intersection de la droite représentant les contraintes matérielles (ressources/budget) et de la courbe d’indifférence la plus élevée possible.
La référence à l'optimum de Pareto a permis aux économistes néoclassiques de démontrer mathématiquement la supériorité théorique de la concurrence pure et parfaite sur les modèles économiques alternatifs, à partir de leurs postulats.
Citations:
- « La tendance à personnifier les abstractions, ou même seulement à leur donner une réalité objective, est telle que beaucoup de personnes se représentent la classe gouvernante presque comme une personne, ou au moins comme une unité concrète qu'ils lui supposent une volonté unique, et croient qu'en prenant des mesures logiques, elle réalise les programmes. C'est ainsi que beaucoup d'antisémites se représentent les sémites, beaucoup de socialistes les bourgeois. » (in Traité de sociologie générale, §2254)
- « Si en France on établit l’impôt sur le revenu, on commencera avec un taux progressif fort supportable, et puis, chaque année, à l’occasion du budget, on l’augmentera. »[1]
- « Il est doux de prendre sa part d'un impôt qu'on ne paie pas. »
- « Tous les révolutionnaires proclament à leur tour que les révolutions précédentes ont fini par tromper le peuple ; c'est leur révolution seule qui est la vraie révolution. « Tous les mouvements historiques précédents », déclarait le Manifeste communiste de 1848, « étaient des mouvements de minorités ou dans l'intérêt de minorités. Le mouvement prolétarien est le mouvement conscient et indépendant de l'immense majorité, dans l'intérêt de l'immense majorité ». Malheureusement cette vraie révolution, qui doit apporter aux hommes un bonheur sans mélange, n'est qu'un mirage trompeur qui ne devient jamais une réalité. Elle est apparentée à l'âge d'or des millénaristes : toujours attendue, elle est toujours perdue dans les brumes du futur, échappant toujours à ses adeptes au moment où ils pensent la tenir. »
- « Même si on démontrait d'une façon tout à fait évidente que la protection entraîne toujours une destruction de richesse, si on arrivait à l'enseigner à tous les citoyens, tout comme on leur apprend l'ABC, la protection perdrait un si petit nombre de partisans, le libre-échange en gagnerait si peu, que l'effet peut en être à peu près négligé, ou complètement. Les raisons qui font agir les hommes sont tout autres. » (Manuel d'économie politique)
- « Vilfredo Pareto, peut-être le fondateur d’une approche explicitement positiviste en économie, était le champion des deux erreurs. Rejetant l’approche de la préférence démontrée comme “tautologique”, il cherchait d’un côté à éliminer les préférences personnelles de la théorie économique, et de l’autre à étudier et à mesurer des échelles de préférences indépendamment de toute action réelle. Pareto est donc, à plus d’un égard, l’ancêtre spirituel de la plupart des théoriciens contemporains de la valeur. » Murray Rothbard (“Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics”)
Œuvres:
- 1892, “Considerazioni sui principii fondamentali dell’economia politica pura”, Giornale degli economisti, maggio 1892: 389-420, reproduit en 1982, in Ecrits d’économie politique pure, in Vilfredo Pareto, OEuvres complètes, tome XXVI, Genève: Librairie Droz
- 1895, “La legge della domanda”, Giornale degli economisti, janvier 1895 : 59-68, reproduit en 1982, in Vilfredo Pareto, Ecrits d’économie politique pure, in Vilfredo Pareto, OEuvres complètes, tome XXVI, Genève: Librairie Droz
- 1896, La courbe de la répartition de la richesse, Université de Lausanne, Recueil publié par la Faculté de Droit à l’occasion de l’exposition nationale suisse, Genève, 1896, reproduit en 1967, in Vilfredo Pareto, Écrits sur la courbe de la répartition de la richesse, in OEuvres complètes, tome III, Genève
- 1896, Cours d’économie politique, Lausanne : Rouge, 1896-7, reproduit en 1964, in Vilfredo Pareto, OEuvres complètes, Genève : Librairie Droz
- 1900, “Sul fenomeno economico, lettera a Benedetto Croce”, Giornale degli Economisti, août 1900: 139-162, p. 144, reproduit en 1982 in Ecrits d’économie politique pure, in Vilfredo Pareto, OEuvres complètes, tome XXVI, Genève: Librairie Droz
- 1903, “Anwendungen der Mathematik auf Nationalökonomie”, Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwendungen, Leipzig, vol. I, n° 7, traduction française en 1966, in Statistique et Économie Mathématique, OEuvres Complètes de Vilfredo Pareto, t. VIII, Genève : Librairie Droz
- 1906, Manuel d’économie politique, Piccola Bibliotheca Scientifica, Milano : Società Editrice Libraria,
- - 1ère édition française en 1909, Paris : Giard et Brière, 1909,
- - 4ème édition en 1966, in OEuvres Complètes de Vilfredo Pareto, Genève : Librairie Droz
- 1908, “Economia sperimentale”, Giornale degli Economisti, juillet : 6-18,
- - Traduction française en 1976, in Faits et Théories, Genève : Librairie Droz
- 1916, Trattato di Sociologia Generale, Florence : Barbera
- - Traduction française en 1968, réédition in Œuvres Complètes de Vilfredo Pareto, Genève : Librairie Droz, 1968
- 1918, “L’interpolazione per le ricerca delle leggi economiche”, Giornale degli economisti, maggio 1907: 366-385,
- - Reproduit en 1982 in Ecrits d’économie politique pure, in Vilfredo Pareto, OEuvres complètes, tome XXVI, Genève: Librairie Droz
- 2008, Le Péril socialiste, recueil d'articles, éditions du Trident.
Littérature secondaire:
- 1968, S. E. Finer, "Pareto and Pluto-Democracy: The Retreat to Galapagos", American Political Science Review, 62 (2), pp440–450
- 1999,
- Alban Bouvier, dir., Pareto aujourd'hui, Presses Universitaires de France, Paris
- Carlo Lottieri, Elitisme classique (Mosca et Pareto) et élitisme libertarien: analogies et différences, In: Alban Bouvier, dir., Pareto aujourd'hui, Presses Universitaires de France, Paris, pp199-219
- 2006,
- Richard Bellamy, "Vilfredo Pareto", In: J. Scott, dir., "Fifty Key Sociologists: The Formative Years", Routledge, pp128-131
- Philippe Steiner, "Vilfredo Pareto et la révision du libéralisme économique classique", In: Philippe Nemo et Jean Petitot, dir., Histoire du libéralisme en Europe, Collection Quadridge, Presses Universitaires de France
Notes et références: